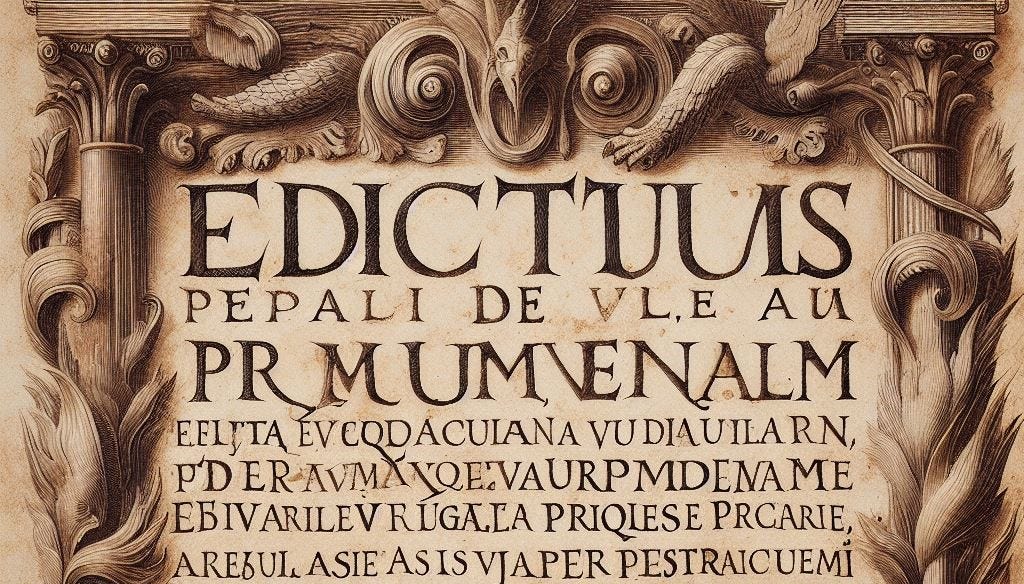Dioclétien, un keynésien avant l’heure ?
Deuxième partie de la série d'articles consacrés aux crises monétaires de l'Empire romain. Personnage clé, Dioclétien participe encore plus à fragmenter la monnaie d'un Empire déjà fragile.
Dans un précédent article nous sommes revenus sur la crise du troisième siècle qui a presque vu l’Empire romain disparaître en même temps que sa monnaie référence, le denarius. A la fin du troisième siècle, un nouvel empereur, Dioclétien, décide un ensemble de réformes dans le but de remettre sur les rails une économie romaine à la dérive. Sans surprise, son interventionnisme économique est un échec. Ce sont surtout ses réformes administratives qui bénéficieront le plus à Rome.
Dioclétien, du bon et (surtout) du mauvais
À la fin de la “Crise du Troisième siècle”, Dioclétien (284 - 305) entend réformer l’Empire et régler le problème de la monnaie qu’il perçoit comme potentiellement dangereux. Il réintroduit en ce sens les anciens poids en métaux précieux des unités monétaires : le denarius est ressuscité avec un poids fixé à 3.40 grammes pour 95% d’argent. Le très haut pourcentage d’argent de cette nouvelle pièce contraste avec le monnayage alors utilisé. Mais un problème se présente : le manque de matières premières nécessaires à la frappe de ces nouvelles monnaies.
Soucieux que sa réforme voit le jour, Dioclétien décide de saisir les métaux précieux détenus par les citoyens, ce qui n’est pas sans rappeler l’Executive Order 6102 seize siècles plus tard, et d’augmenter considérablement les impôts. L’opération s’avère compliquée et les résultats laissent à désirer. Quand les premières unités monétaires en argent sont émises, la qualité et la valeur intrinsèque de celles-ci contrastent avec la piètre qualité des pièces que la population romaine utilise au quotidien.
Les citoyens ne s’y trompent pas : aussitôt émis, l’argenteus est en priorité thésaurisé et ne sera que très rarement utilisé comme intermédiaire d’échange. Le problème de la thésaurisation et de la disparition de la “bonne” monnaie de l’économie réapparaît. Cette fois-ci ce ne sont pas les pièces les plus anciennes qui sont thésaurisées, mais les nouvelles pièces émises.
Le nouveau monnayage impérial est un échec. Afin de faire face à une crise qui ne se résorbe pas, Dioclétien décide des dépenses budgétaires importantes. Ces politiques “keynésiennes” (si nous pouvons oser l’anachronisme) impressionnent par leur ampleur. Trente-cinq nouvelles légions sont créées, doublant les effectifs de l’armée, de nombreux travaux publics, comme des routes, des forteresses et des ponts, sont entrepris afin de donner du travail à la population. Une refonte totale (et pertinente) de l’administration provinciale, renforcée dans ses effectifs, voit le jour. À cette époque, l’historien Lactance ironise sur le fait que les travailleurs publics dépassent en nombre les contribuables romains…
L’intervention de Dioclétien pour redresser l’économie part, comme toujours, d’une bonne intention. Malheureusement, l’inflation nécessaire à ses grands projets ne fait qu’aggraver la situation. Le pouvoir d’achat de la monnaie baisse considérablement, conséquence de quoi les prix explosent suivant une inflation annuelle qui passe de 5% en 284 à 35% en 301. Persuadé que la hausse des prix est une conséquence de la thésaurisation et de la spéculation, Dioclétien décide d’instaurer un paiement de l’impôt impérial directement en nature. Le monnayage impérial étant de plus en plus de mauvaise qualité, cette décision permet de redresser la qualité des revenus perçus par l’administration romaine. L’empereur romain prend également une autre mesure pour lutter contre ce qu’il pense être de la spéculation malhonnête : le contrôle des prix.
Le contrôle des prix comme réponse à l’inflation
C’est l'Édit du Maximum de 301, Edictum de pretiis rerum venalium (Edit sur les prix des marchandises) qui fixe un prix maximum sur plus de 1000 marchandises, services et salaires à travers l’Empire romain. Dans la pure tradition romaine, un non-respect de cet édit était puni par la peine de mort. Les conséquences de cet édit et de cette tentative inédite d’un contrôle des prix à une échelle si grande sont mal connues. Malgré ces manques d’informations pour l’historien, nos connaissances actuelles nous enseignent que le contrôle des prix est certainement le pire remède pour lutter contre la hausse des prix causée par l'inflation. Cela mène automatiquement à une pénurie des biens et des services concernés.
L'impossible ajustement à la hausse des prix, alors que les coûts de production augmentent toujours, ne fait qu’aggraver la situation. La hausse artificielle de la demande et la baisse contrainte de l’offre rendent les pénuries inévitables.
Cet édit a sûrement contribué à déliter encore un peu plus la société romaine en faussant un calcul sain du processus économique et des échanges. L’exode urbain, qui prend de plus en plus d’ampleur à cette période, est certainement une conséquence de cette inflation et de ces contrôles de prix qui ont mené les artisans et les marchands des grandes villes à cesser leur activité, ne pouvant plus produire et commercer à perte.
Malgré la peine lourde encourue en cas de non-respect, cet édit s’avère impossible à mettre en place et à faire respecter dans l'ensemble de l'Empire. C’est le cas notamment dans les provinces les plus éloignées de Rome, comme l’Egypte, où se développe un marché noir important. Il sera plus tard révoqué.
Le retour de l’échange direct, signe ultime du déclin.
Face à la perte de valeur rapide du monnayage et aux contrôles des prix destructeurs, la population commence également à privilégier d’autres moyens d’échange dont des monnaies locales et le troc.
Le retour du troc à la fin du troisième siècle souligne un retour en arrière phénoménal vers un moyen d’échange primitif. L’indivisibilité des biens échangeables et la “double coïncidence des besoins”, qu'un retour aux échanges directs implique, condamne de manière certaine l’Empire.
Les échanges diminuent, ceux-ci deviennent directs, limités dans le temps, dans l’espace et à des cercles d’échanges restreints. L’Empire romain avait jusqu’ici bâti sa force sur une économie basée sur une division du travail et des compétences complexes alors inégalées dans l’Histoire, tant par l'étendue géographique concernée et par le nombre d'individus impliqués. Le retour à des échanges directs signe indirectement la fin d’un Empire qui ne fédère plus.
“La combinaison d’un système de prix maximum avec la dégradation de la monnaie provoqua la paralysie complète tant de la production que de la commercialisation des denrées alimentaires essentielles, et la désintégration de l’organisation sociale de l’activité économique.”
Ludwig von Mises, Sur les causes les causes du déclin des anciennes civilisations, l’Action humaine. p 889 - 892
L’inflation, la hausse et le contrôle des prix, le retour du troc et la fin de la spécialisation via la division du travail provoque un appauvrissement important de la population urbaine. Au troisième et quatrième siècles cela se traduit par un phénomène d’exode urbain important, les villes ne sont plus les lieux d’échanges et de richesses qu’elles furent aux grandes heures de l'Empire. Les artisans spécialisés et autres marchands retournent à la terre.
À plusieurs reprises, les empereurs tentent de régler ce problème d’exode généralisé par des édits fixant les citoyens dans des corps de métier fixes, parfois même de manière héréditaire, ou à des zones géographiques spécifiques. Ces mesures restrictives de libertés n’y font rien. Le phénomène de restructuration sociale est en marche dans l’Empire et pose les bases d’une nouvelle structure organisée en cercles d'échange restreints autour des domaines. L’économie de subsistance devient la norme : elle est plus localisée, directe et autarcique.
En somme, la matrice de l’époque médiévale à venir.